Place
N°1 - Janvier/January 2019
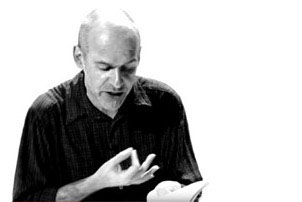
Jan Baetens
résider mobile dans
le monde mobile
Entretien avec Vincent Tholomé
réalisé le 17 septembre 2018


Jan Baetens : L’écrivain qui accepte de faire une “résidence” s’engage en principe à produire un texte en lien direct avec l’institution ou le lieu qui l’accueille, mais le cahier des charges reste souvent assez flou. Est-ce que tu serais en faveur d’une description plus préciser de ce qu’on attend des auteurs ou penses-tu que cela n’a pas beaucoup de sens, par exemple lorsque le lieu en question ne s’y prête pas vraiment ou que l’auteur choisi développe une forme d’écriture qui va dans un tout autre sens ?
Vincent Tholomé : Il existe, en fait, plusieurs types de résidence. Certaines te demandent explicitement de « travailler » avec le territoire, d'en rencontrer les habitants. De proposer, par exemple, tout un travail d'atelier dans les écoles, dans les bibliothèques, auprès de publics composés aussi bien d'enfants que d'ados ou d'adultes. Avant même de commencer, tu sais que ce travail « sur le terrain » te prendra minimum la moitié de ton temps. Généralement, ce type de résidence te laisse « libre » d'occuper comme tu l'entends le reste de ton temps. Pas d'exigence explicite, donc, de produire un texte en lien avec l'institution ou le territoire qui t'accueille. À l'inverse, d'autres résidences proposent que tu mettes l'accent sur la création plutôt que sur les rencontres, échanges, etc. Ici, en fonction de l'institution, de ses attentes, de ses habitudes, de sa « philosophie », tu auras à produire un texte en lien direct avec la ville ou le lieu qui t'accueille. Enfin, d'autres encore – peut-être la majorité d'entre elles ?, je ne sais pas – sont un mix des deux : tu rencontres des publics, des habitants mais tu disposes d'assez de temps pour te plonger dans tes propres affaires, dans l'écriture de tes manuscrits en cours ou – le cas échéant, en fonction de l'inspiration, des envies, des demandes, etc. – dans l'écriture d'un texte totalement neuf, ancré dans la réalité du terrain. En fait, mis à part le cas des résidences clairement axées sur la création, le mode de fonctionnement, les demandes et exigences sont assez flous dès que la résidence proposée mêle écriture(s) et rencontres. Tout reste dans le non-dit ou l'à peine formulé. Comme si l'on marchait ici sur des œufs. Comme si, parce qu'on demande à l'auteur, à l'autrice, de « travailler sur le terrain », on n'osait pas clairement aborder la création d'un texte lié au lieu ou à l'institution. Faudrait-il dès lors préciser les choses ? Les inscrire noir sur blanc dans une espèce de contrat en bonne et due forme ? Pas sûr. Il existe bel et bien une zone de flou. Ce n'est pas si mal. Cela permet, en tout cas, aux auteurs et autrices de « bien vivre » ce temps de résidence : cela crée un espace de liberté dans lequel on peut s'immerger, faire des choix, choisir de graviter autour de ses manuscrits en cours ou de se plonger dans du neuf, imprégné de ce que l'on sent, de ce que l'on capte du territoire. Ou de faire un peu des deux. Et puis : si ce flou inquiète, pose question, on peut toujours discuter, mettre le sujet sur la table, sortir du non-dit. À l'autrice, à l'auteur, de sentir, en tout cas, ce qui l'arrange le mieux, le met le plus à l'aise.
Quant au sens que cela peut avoir d'écrire « obligatoirement » sur un lieu, oui, on peut s'interroger. Pas de garantie, en effet, qu'il y aura osmose, que ça « collera » entre toi et le territoire. Pas de garantie que ce que tu écriras ne relèvera pas de l'exercice de style plutôt que de l'écrit « bien senti », en adéquation avec ce que tu es, ce que tu désires, ce qui te porte vraiment, dans la période de ton existence que tu es en train de vivre. Ça peut, parfois, prendre l'allure d'un pile ou face, oui. Ce qui compte – je parle ici en tant qu'auteur –, c'est que tu aies, en tout cas, suffisamment de liberté pour, le cas échéant, changer de cap, inventer un nouvel agencement, un de ceux qui te font avancer, grandir, un de ceux qui est comme un petit vent frais qui te pousse dans le dos.
J.B. : Quelles sont tes expériences personnelles en la matière, et existe-t-il selon une forme idéale qui permettre de créer un vrai rapport entre un auteur et un lieu ?
V.T. : Il n'y a pas de formule idéale, je pense. En tout cas, l'exigence d'un cadre fixe, fixé une bonne fois pour toutes, identique pour toutes les résidences, quelles qu'elles soient, ne serait pas suffisant. Louperait même l'essentiel. C'est qu'une résidence, ça s'invente à plusieurs, de façon ouverte : je pense qu'il est extrêmement important d'être ouvert aux « accidents », aux « imprévus ». Une résidence est riche si, à tout moment, elle peut bifurquer, prendre un tour inattendu. Ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'une résidence ne devrait qu'imprévus. Je pense plutôt ceci : un cadre clair, déposant sur la table les exigences et les envies, du lieu d'accueil comme des résidents, est plus que bienvenu – pas de mauvaises surprises ainsi, ou de « retours de flamme » –. Cependant durant une période de résidence, événements, rencontres, opportunités, occasions uniques, peuvent survenir au quotidien. Le tout est de savoir qu'en faire. Le tout est de saisir, rapidement, si, oui ou pas, cette occasion-ci pourrait apporter un réel « plus » à ta résidence, cette occasion-là ne t'apporterait que des tracas, etc. Une résidence, ça se prévoit, ça se prépare au mieux des semaines voire des mois à l'avance mais ça se construit aussi, au petit bonheur, au jour le jour. Et puis, le rapport au lieu de résidence, le rapport aux voisins de palier, le rapport au territoire, la « friction » avec le monde, le fait de se préoccuper essentiellement de création, d'être comme « hors de ta vie quotidienne », etc., tout cela fait que, oui, tu n'es plus au monde comme tu l'es d'habitude. Sans doute que cela te rend plus poreux, plus perméable à ce qui se passe autour de toi, aux personnes qui gravitent autour de toi, autour desquelles tu gravites aussi. On peut dire que la résidence est une belle occasion de vivre intensément ton rapport au monde, au climat, à la terre que tu foules, aux personnes que tu croises, etc.
J.B. : Kirkjubaejarklaustur, dont tu lis ici un fragment, est-il un texte né d’une commande ou au contraire un projet né au gré des circonstances, en l’occurrence un voyage en Islande ? Et comment vois-tu la part de ce séjour dans l’écriture très singulière de ce roman (à commencer par le fait que Kirkjubaejarklaustur est un roman, ce qui n’est pas forcément le genre que tu adoptes spontanément) ?
V.T. : Kirkjubaejarklaustur n'est pas un texte de commande. Ce serait plutôt un texte inattendu. Même pas né au gré des circonstances, à l'occasion d'un voyage mais plutôt né, de façon totalement imprévue, dans l'après-voyage, un an après avoir visité, en touriste, une partie de l'Islande. Je ne me souviens plus de ce sur quoi je travaillais à l'époque, un an après le voyage, mais, tout d'un coup, lors d'une formation à l'animation d'atelier d'écriture, je me suis mis à écrire sur l'Islande alors que je ne pensais même plus à l'Islande, alors que le voyage en Islande était « derrière moi » pour ainsi dire. Tous les textes écrits lors de cette formation ne parlant que de cela : l'Islande et des sensations brutes et abruptes, de la « friction » avec la terre et le climat islandais. Les textes écrits lors de cette formation ont été les germes du livre, en ce qui concerne sa trame, du moins. La langue de Kirkjubaejarklaustur est née, quant à elle, au fur et à mesure que j'écrivais, reprenais l'affaire. Tâchant à la fois d'aller « droit au but », comme dans la vieille littérature islandaise, comme dans les sagas, tout en usant d'une langue bancale, jamais sûre d'elle-même, agglutinant les choses – les mots et les événements – comme des amas ou des textures plutôt que cherchant à les exposer dans un récit « bien écrit ». Ça a donné, je pense, une langue âpre et « brute de décoffrage » comme on dit. C'était une langue adéquate, je pense, à rendre un peu compte de ce que c'est que d'être « là-bas », dans les champs de lave, dans les brouillards, les failles, les mousses, perdu, en quelque sorte, au beau milieu d'une bourgade de bout du monde, cherchant son chemin entre trois baraquements colorés à l'extrême et un bras d'océan.
J.B. : Y a-t-il selon toi, et dans ta pratique, une différence entre l’écriture en résidence et l’écriture en voyage, celle-ci étant généralement plus « mobile », plus « nomade » que celle-là ? Ou est-ce que leur différence s’annule une fois que l’écrivain rentre chez lui pour élaborer a posteriori un certain rapport au lieu ?
V.T. : L'une et l'autre peuvent se concevoir, d'emblée, comme des écritures mobiles, je pense. Ouvertes aux aléas, aux accidents, rencontres, etc. Des écritures « à fleur de peau » en quelque sorte. Que l'on bouge ou que l'on soit attaché à un lieu – tenu à résidence –, on se frotte à l'inconnu. Ça fait « bouger les lignes », en quelque sorte. Fait bouger l'écriture. Me pousse, en tout cas, personnellement, à chercher d'autres « stratégies » d'écriture. À être plus poreux. Plus ouvert à l'improvisation. À moins « serrer les boulons » ou « construire solide ». Cette part d'impro, quasi musicale, ayant, en tout cas, dans la façon dont je me la représente, bien des affinités avec l'impro musicale, avec ce que je sais de l'impro musicale, cette façon de laisser « flotter la langue », de lui permettre de passer d'une impulsion à l'autre, d'une idée à l'autre, d'une sensation ou d'un événement à l'autre, oui, cette part d'impro est, personnellement, un bonheur d'écrire. Comment en garder la vivacité ensuite, dans les jets et moutures ultérieures ? Comment ne pas « tuer le texte » dans les jets et moutures ultérieures ? Cela me préoccupe énormément. Cela est au cœur même de mon envie d'écrire, de « raconter des histoires ». Je suis pour l'instant en train d'écrire quelque chose, intitulé KIVU, gravitant autour d'un lieu et d'une expérience lointaine, gravitant autour de trois rues, d'un marché et d'une placette d'une bourgade sise aux bords du lac Kivu. Comment rendre un peu de l'intensité qu'il y a à « tomber dans l'Afrique », à « tomber dedans » pour la première fois ? Comment si ce n'est en faisant « vibrer » les choses ? Comment faire « vibrer » les choses si ce n'est en improvisant, en laissant, en tout cas, une large part à l'improvisation ? En fait, je me rends compte, à l'instant, en répondant à tes questions, à quel point il y a une analogie, dans la manière dont je conçois les choses, entre « être en résidence » et « écrire » ! Dans les deux cas, ça se passe bien, ça t'exalte, te porte loin, s'il y a à la fois cadre et impro, si tout est à la fois préparé et extrêmement libre d'accueillir ce qui survient. Étrange, non ?
J.B. : Est-ce qu’il existe une analogie entre le travail de l’auteur qui écrit « ‘sur place » sur un certain nombre d’éléments locaux et le travail du peintre sortant du studio pour aller travailler « sur le motif » ? Et cette analogie, pourvu qu’elle existe, concerne-t-elle d’abord les contenus ou les manières de faire (par exemple en poussant l’écrivain à « improviser ») ?
V.T. : En tout cas, ça te pousse à concevoir l'écriture comme autre chose qu'un « simple » contenu. Tout ce qui surgit dans ton texte, les événements rapportés, les silhouettes ébauchées, les circonstances abordées, etc., ne « tient » que par l'écriture, n'a d'intérêt que parce qu'ils se « noient » dans le texte, deviennent textes, textures plutôt, curieuses ondes vibratiles, verbales, visuelles et sensorielles. Ça ne peut pas se prévoir. C'est une expérience à vivre. Tu convoques des choses sur la page, ou plutôt des choses, événements, silhouettes, etc., s'invitent sur ta page, surgissent sur ta page, sous forme de mots, de bouts de phrases bancales, d'agencements fragiles entre deux ou trois événements. Une fois là, tu composes avec eux, tu composes avec elles. Un peu comme un sculpteur en fait. Tu sculptes de la matière brute en ne sachant pas du tout où tu vas. En te laissant surprendre par les plis de la matière, par la façon dont la matière influe ta main, ton esprit, tes pensées. On sculpte ainsi avec des mots plutôt qu'avec la pierre, le bois, etc., on sculpte avec l'air, en somme, du vent, mais on sculpte tout de même. Ça laisse des traces sur la page ou sur l'écran. Ça prend petit à petit du volume. Ça fait masse après, disons, quatre ou cinq mois.
J.B. : Quelle est en général l’incidence du lieu, à la fois le lieu de travail (bureau, café, train, etc.) et le l’environnement social et géographique, sur ton écriture ? Est-ce que tu sens par exemple un impact de la langue ou des langues parlées autour de toi sur ton travail ? Y a-t-il une forme d’imprégnation, et est-ce que ce type d’échange diminue ou s’intensifie avec le temps ?
V.T. : À dire vrai, j'écris comme une éponge, le texte pouvant partir ailleurs à tout moment, tout cela parce qu'une image, un mot entendu en ville, une ombre portée sur mon bureau, un souvenir, une idée brusque, un commentaire à la radio, une actualité, une colère subite chez le voisin d'en face, etc., aurait surgi, perturbant pour de bon le « plan du jour ». Loin de diminuer avec le temps, ce type d'échanges avec le monde s'intensifie. À tel point que je m'en suis inquiété, ai « perdu du temps » à chercher un moyen de contrer l'affaire. À me tenir enfin à des « plans » plutôt qu'à creuser des stratégies me permettant de faire avec, d'inventer et d'avancer avec. En fait, il y a une tension permanente entre le fait de flotter comme un nuage et la vieille obsession de trouver un sens à tout cela, de mener la barque, d'être un pilote responsable dans l'avion. Le mieux serait, je pense, dans mon cas, de poursuivre sur cette pente. D'arrêter de me poser des questions. KIVU, le texte en cours d'écriture, est une façon de pousser les choses encore plus loin, de les lancer sur dans une pente ultra savonneuse, non pas n'importe comment, non pas « qui vivra verra » : rien de pire que de se lancer dans l'impro sans cadre – je veux dire : sans une stratégie te permettant de garder distance, de ne pas te « noyer ». C'est que, si tu te décides à écrire perméable, si tu décides à être potentiellement poreux à tout, le monde te déborde et te dépasse assez vite, le monde te submerge. Comment, dès lors, garder, malgré tout, la tête hors de l'eau malgré le monde et ses débordements ? Voilà toute la question, tout ce qui me tarabuste pour l'instant.
J.B. : Est-ce que tu écris aussi pour le public local, et si oui, pourquoi et comment ? Ou est-ce que la présence de ce public (et sans doute du public en général) ne se fait sentir qu’au moment de la performance, qui pour toi fait partie de n’importe quel processus d’écriture ?
V.T. : J'aime expérimenter. Emprunter des voies que je ne connaissais pas encore. Tester des choses. Si tu navigues dans ces eaux-là, tu sais que la plupart des personnes qui te liront ou entendront seront, disons, désorientées. Ne sachant pas trop par quel bout prendre ce que tu proposes. Important, dès lors, à mes yeux, de tenir compte de ce fait. D'écrire avec ce fait. Je pense que la plupart des choix d'écriture que j'ai faits – écriture du « quotidien », phrases « simples », répétitions, creusements obsessionnels, peu de métaphores ou de « langage fleuri », etc. – tient, en partie du moins, au fait que, oui, j'aime lire, performer, devant « n'importe qui », des hommes, femmes ou enfants qui, peut-être, n'ont aucune idée de ce que sont les lectures performances ou de ce qu'est la poésie aujourd'hui – une possible poésie aujourd'hui –, ont une image assez curieuse de ce qu'est un auteur aujourd'hui. Dès lors, il m'importe de tisser des liens. De donner à entendre des choses audibles. De donner à lire des choses lisibles – même si, parfois, cette langue faite à coups de marteau désarçonne ou irrite. Je me dis que, déjà, le fait d'expérimenter, de donner à lire et entendre des choses expérimentales, ça déroute pas mal. Pourquoi, de plus, en rajouter une couche en usant de phrases, de mots, de tournures hyper complexes, passant au-dessus de la tête de nos contemporains ? Bref, j'écris et je performe en croisant les doigts, en somme, en espérant que quelque chose, malgré tout, passe, puisse passer, même – et surtout – auprès de publics totalement étrangers au petit monde de la poésie ou de la littérature dite expérimentale. Aucune idée si cela fonctionne, bien sûr ! Mais, bon, la tentative est là. La porte est ouverte.
J.B. : Quels sont les textes ou les auteurs qui font sentir le mieux l’importance du lieu, que ce soit en termes de contenu ou, de façon plus intrigante encore, de la forme et du style. Humbert Humbert écrit en prison, par exemple, en on ferait une lecture erronée de Lolita en oubliant cet aspect capital…
V.T. : J'ai toujours un peu de mal à sortir ainsi, spontanément, des titres ou des noms mais, à coup sûr, sur cette affaire de lieu, il y aurait Glose, un livre de Juan Jose Saer, un écrivain argentin ayant vécu en exil, en France. La plupart de ses romans – si pas tous –, qu'ils traitent de réalités contemporaines et de la colonisation espagnole, se déroulent dans une petite région d'Argentine, là où il a vécu, Saer ressassant sans cesse le lieu, le gardant d'autant vif qu'il en était éloigné. Glose se compose de trois parties relatant trois fois sept cent mètres d'une promenade en ville, effectuée, vingt à trente ans auparavant, par deux amis, la ville, son trafic automobile, ses boutiques, ses habitants, surgissant alors au beau milieu de la conversation non comme un simple décor mais comme une des choses dont il faudrait se souvenir, ne jamais laisser sombrer dans l'oubli. Grande leçon d'écriture, à mes yeux, que ce Glose : la façon, toujours limpide, dont Saer « glisse » d'un élément à l'autre, d'une situation à l'autre, est tout simplement sidérante. Il y aurait aussi, autre leçon, mais dans le cinéma cette fois-ci, et de façon nettement moins « baroque », les films de Yasujirô Ozu, le parti-pris d'Ozu de poser la caméra à ras-de-tatami, pour ainsi dire, et ses images de couloirs de bureau ou de bouts d'usine se détachant du ciel.
J.B. : Un lieu n’est jamais quelque chose d’abstrait, c’est aussi une image, au sens très matériel du terme. Est-ce que tu prends des photos au moment de l’écriture, et quelle est la fonction de ces images ? Aide-mémoire ? Partie intégrante du texte ? Texte tout court ? Et comment travailles-tu le rapport entre image et son, rythme et sonorité étant parmi les propriétés les plus élaborées de ton style ?
V.T. : Confidence : je ne vaux pas grand chose en terme de prises d'image, qu'elles soient photographiques ou cinématographiques ! Du coup, je ne prends, pour l'instant du moins, ni photos ni vidéos. Mais j'en regarde beaucoup. Je m'en inspire beaucoup. Des pans entiers de KIVU sont issus de photos vues sur le net. De vidéos vues sur le net. J'aime aussi me rendre sur Googlemaps. Zoomer au maximum et repérer dans l'image un détail qui m'inspirera ou m'inspirerait. Me remémore aussi tel ou tel plan de films. Plus « matériellement » – mais au niveau du texte, cette fois-ci, plutôt que sur le plan des images –, il m'est arrivé une curieuse impression, en écrivant certains bouts de KIVU, celle de remarquer que je « construisais » ces fragments comme des réalisateurs concevraient leurs films : enchaînements de plans fixes et de gros plans, enchaînements de plans ultra mobiles et de vues plongeantes, etc. Envie aussi d'écrire « à la William Gaddis » – quelle ambition, mon dieu ! –, je veux dire : écrire au plus près de l'image, des sensations, ne rien écrire qui ne serait pas, d'une certaine façon, audible ou visible au cinéma, dans une salle de cinéma – vieux conseil d'écriture de scénario, je pense, non ? –. Bon nombre de fragments de KIVU ont été ainsi conçus, sont en train d'être conçus, comme des « vignettes », des choses ultra visibles – et audibles aussi, bien sûr, le rythme, le son et l'image – ce que la langue finit par « donner à voir » – étant, oui, indissociables.
